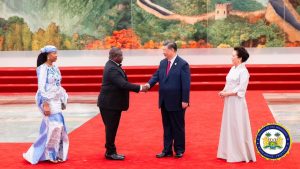Après deux ans de travaux, le mandat de la commission parlementaire consacrée au passé colonial se termine le 31 décembre et ne débouche sur rien.
Non, rien de rien… Après deux ans de travaux, d’auditions, un voyage sur place, un rapport exhaustif et détaillé, le mandat de la commission parlementaire consacrée au passé colonial de la Belgique se termine le 31 décembre et ne débouche sur rien. « Non, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal, tout ça m’est bien égal… » Edith Piaf aurait pu être invitée à la dernière séance. Il n’y aura pas de réparations, pas de fondation et, surtout, pas d’excuses. Paradoxalement, c’est le roi Philippe qui, exprimant à Kinshasa ses « profonds regrets », est allé le plus loin et les libéraux ont sans doute estimé que cela suffisait.
Il n’y a pas eu de consensus sur une déclaration finale, même lorsque les écologistes, à la veille de cet échec imminent, proposaient de sauver toutes les autres résolutions et d’abandonner le point d’achoppement des « excuses », en attendant que les esprits, en mûrissant, acceptent de tirer la conclusion logique d’un rapport aussi détaillé qu’accablant.
Puisque la suggestion de dernière minute énoncée par le député socialiste Christophe Lacroix (créer une fondation qui développerait des projets – et créerait des emplois ?) n’avait pas été retenue, le PS ne livra pas bataille, refusant l’ultime compromis. Au regard de l’histoire longue, il ne faut guère s’en étonner : les socialistes n’ont jamais été associés à l’entreprise coloniale, en 60, à la veille de l’indépendance ratée, ils étaient absorbés par les grandes grèves, et par la suite, Edmond Leburton et quelques autres s’accommodèrent fort bien du régime Mobutu. Au Congo/Zaïre comme au Rwanda, les socialistes cédèrent toujours la main aux catholiques, flamands et francophones, et beaucoup estiment que si la gauche officielle, dont le ministre des Affaires étrangères Willy Claes, s’était un peu plus intéressée aux dérives du régime Habyarimana, le génocide des Tutsis aurait été plus difficile à mettre en œuvre…
Quant aux libéraux, ils renient un passé dont ils auraient pu s’inspirer : déjà du temps de Léopold II, ils furent les premiers à critiquer le projet colonial et à mener des commissions d’enquête ; Patrice Lumumba lui-même se proclamait libéral, en 2000, Guy Verhofstadt, « au nom de son pays, de son peuple » présenta des excuses au Rwanda et on se souvient de l’engagement de Louis Michel pour tenter de mettre fin aux guerres du Congo. Tout cela appartient au passé. De nos jours, les hommes d’Etat se taisent face aux boutiquiers qui gardent l’œil sur le tiroir-caisse (craignant de devoir verser des réparations qui ne sont même pas à l’ordre du jour…) et sur les sondages, quand ils n’écoutent pas les appels venus d’« en haut ».
Alors qu’au même moment, cruelle coïncidence, les voisins hollandais, appuyés par la Couronne, assument un passé colonial pire que le nôtre, nos parlementaires se séparent les mains vides. Rassurons-nous : leur échec ne changera rien au devenir du Congo, du Rwanda, du Burundi mais il décevra une diaspora qui n’en sera que plus radicale. Cette queue de poisson risque cependant de mettre fin à la réputation d’« expertise » en matière d’affaires africaines que la Belgique, bon an mal an, s’efforçait de préserver. L’impuissance des politiques est aussi un camouflet adressé aux dizaines de milliers de citoyens belges qui ont gardé, à titre personnel ou via des associations, des liens d’amitié, de solidarité, de coopération avec l’Afrique centrale, qui s’émeuvent encore de ses malheurs et partagent ses espérances.